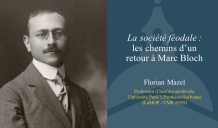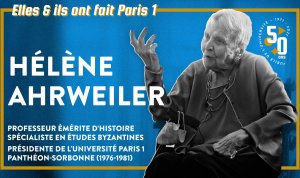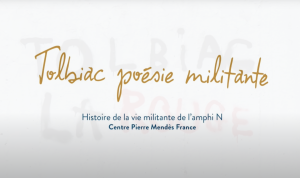Table-ronde / Marc Bloch, l'interdisciplinarité et les sciences sociales
- Histoire / Sciences sociales
- 2025
- 00 s
- Français
Publié le 15/09/2025
Marc Bloch ne souhaitait pas être exclusivement médiéviste, comme il l’écrivait dans une lettre à Henri Berr. Son dialogue avec les sciences sociales, nourri de sa lecture des économistes et des sociologues (de Karl Marx à François Simiand) et de son intérêt pour la politique économique, en faisait un penseur pionnier de la « longue durée ».
Ainsi, dans cette table-ronde animée par Etienne Anheim (Directeur de recherche en histoire médiévale, EHESS), Michel Lauwers (Professeur d’histoire médiévale, Université de Nice-Côte d’Azur), Eliana Magnani (Chargée de recherche CNRS et Directrice du LaMOP, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Guillaume Calafat (Professeur d’histoire contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) abordent plusieurs questions traitées par M. Bloch dans ses recherches, ses comptes rendus, ses cours et ses projets (identifiables dans ses riches archives). Il embrassait en effet volontiers l’histoire de l’époque moderne et l’histoire contemporaine. Ainsi de ses travaux sur la dynamique du capitalisme ou la révolution agricole qui proposaient une histoire pensée avec les problèmes et les méthodes du présent, c’est-à-dire avec l’ensemble des sciences sociales.
La table ronde, fut cependant l’occasion de noter le faible intérêt de M. Bloch pour les travaux de Max Weber, à l’instar des historiens français de sa génération.
Dans sa présentation « Marc Bloch, Marcel Mauss, L’Année sociologique, les Annales et les autres », Eliana Magnani explique notamment que les archives du Collège de France conservent actuellement quelques pièces de la correspondance entre Marc Bloch et Marcel Mauss. Ces lettres permettent de suivre la prise de contact et l’évolution de la relation entre les deux hommes dans des contextes marqués de leur activité professionnelle : de la mise en place de la deuxième série de L’Année sociologique par Mauss aux candidatures de Bloch au Collège de France en passant par la création des Annales. Les trois premières lettres de Bloch à Mauss, sur lesquelles nous nous concentrons ici, portent sur des échanges ayant lieu dans le cadre de ces deux revues emblématiques de l’histoire des sciences sociales au début du XXe siècle et des réseaux de diffusion qu’elles entretiennent et dont elles dépendent. Elles révèlent en filigrane, au-delà des frictions entre disciplines, l’activité concrète déployée alors par tout un groupe de penseurs « des sociétés » dont les travaux s’irriguent les uns les autres.
Dans sa présentation « Marc Bloch sociologue ? La « structure sociale » pour horizon, Michel Lauwers, Professeur d’Histoire du Moyen Âge à l’Université Côte d’Azur explique que Marc Bloch est devenu médiéviste à une époque où les sciences du social, à commencer par la sociologie de Durkheim, alors en plein développement, établissaient l’existence de faits sociaux. Ceux-ci constituent, pour Bloch, l’objet même du travail de l’historien comme de celui du sociologue. L’intervention de Michel Lauwers s’attache tout d’abord à mettre en évidence sa volonté d’étudier la « structure sociale » de l’Europe médiévale, une notion qui devient cardinale dans sa recherche. Sa démarche, qu’il nomme « structurelle » ou « structurale », vise à établir des « liaisons » entre les « divers ordres de phénomènes » observés par l’historien. Michel Lauwers évoque ensuite les sources d’inspiration de Marc Bloch : parmi les historiens, Numa-Denys Fustel de Coulanges et Henri Pirenne ; dans le domaine des sciences du social, Karl Marx, que le médiéviste considère comme le plus grand « analyste social », et Émile Durkheim, dont l’analyse des « forces sociales » et de leur fondement religieux inspira constamment le médiéviste. L’intervention souligne enfin une sorte de tension, dans les réflexions de Marc Bloch, entre sa quête de la « structure sociale » et sa reconnaissance de la part psychologique des faits humains.